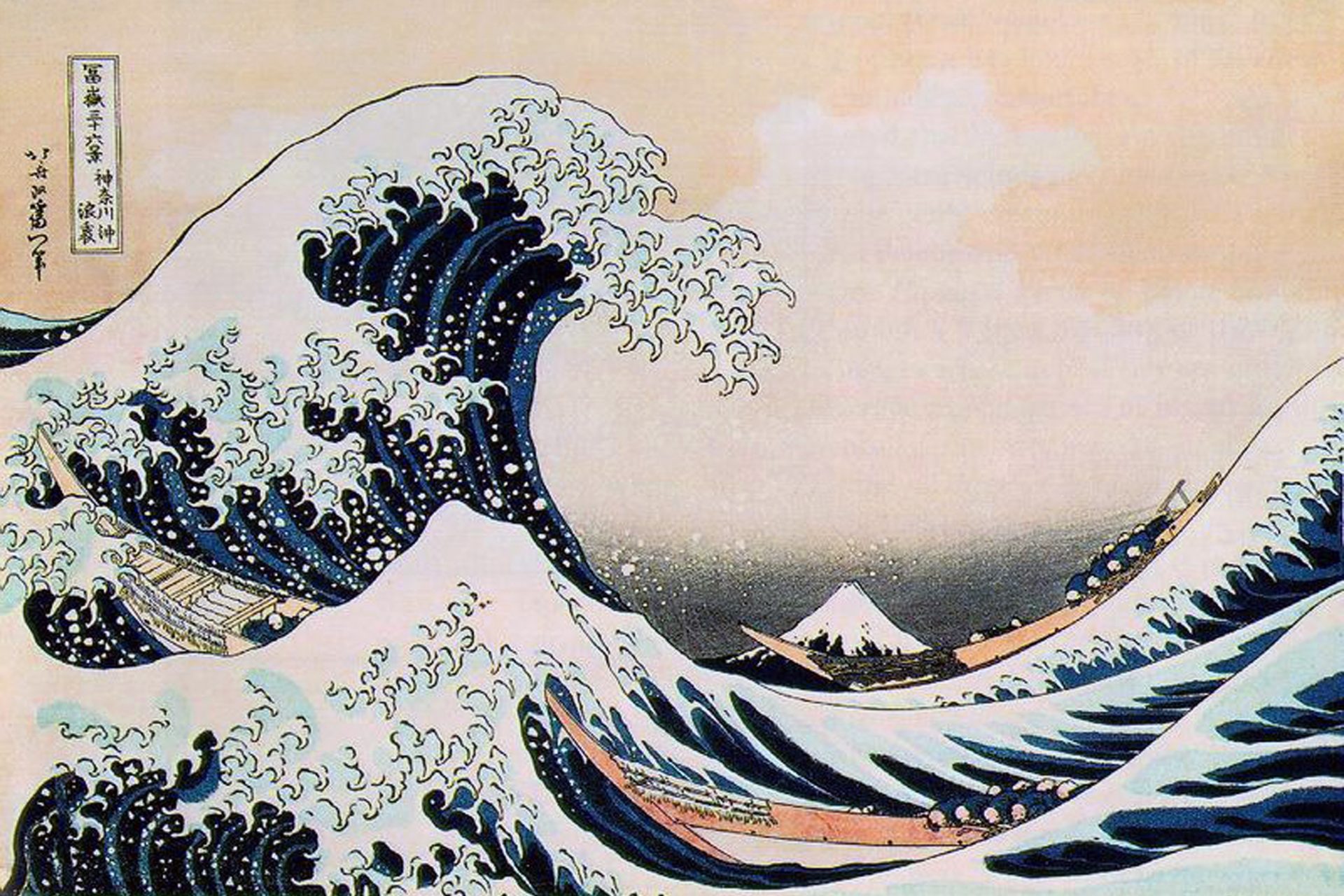L’Europe face à Trump et à Poutine : quelle est la position des différents États ?
Les déclarations récentes de Donald Trump et sa volonté de négocier la paix en Ukraine directement avec la Russie, sans impliquer les Européens, sont un basculement géopolitique majeur pour le Vieux Continent.
Entre l’agressivité de la Russie de Vladimir Poutine et la rupture de fait de la solidarité transatlantique par Washington, l’Europe se trouve aujourd’hui menacée comme elle ne l’a jamais été depuis la Guerre froide.
Face à cette situation inédite et inquiétante, quelle est la position des différentes capitales européennes ? On fait le point en images.
Dès l’annonce des négociations russo-américaines, le président français, Emmanuel Macron, a reçu les principaux chefs de gouvernement européens à Paris lundi 17 février pour échanger sur la situation en Ukraine et sur la sécurité du continent.
Jeudi 20 février, le chef de l’État a répondu en direct aux questions des internautes. Excluant l’envoi de troupes françaises pour combattre en Ukraine, il a déclaré qu’il envisageait « d’envoyer des forces pour garantir la paix une fois qu’elle sera négociée ».
« Je sonne un peu le tocsin ce soir parce que j’ai la conviction qu’on entre dans une ère nouvelle », a poursuivi Emmanuel Macron, cité par le Huffington Post, ajoutant que toute l’Europe doit augmenter son « effort de guerre ».
Même s’il n’est plus membre de l’Union européenne, le Royaume-Uni de Keir Starmer a été invité à la réunion de Paris. Cité par BBC News, le Premier ministre travailliste s’est déclaré « prêt et disposé à déployer des troupes sur le terrain » en Ukraine.
En Allemagne, où des élections nationales ont lieu ce dimanche 23 février, la rupture du partenariat transatlantique est vécue comme un choc tant l’appui américain a été essentiel pour le pays depuis 1945.
Malgré tout, le porte-parole de la CDU, le parti chrétien-démocrate favori des sondages, a déclaré que le pays le plus peuplé d’Europe serait prêt à envoyer des troupes dans un cadre international.
Interrogé sur la possibilité d’un soutien militaire allemand, le chancelier en exercice et candidat social-démocrate aux élections, Olaf Scholz, a déclaré que nous sommes « encore loin d’un cessez-le-feu » en Ukraine, indique le média allemand Frankfurter Rundschau.
La sympathie pour Donald Trump de Giorgia Meloni, la présidente du Conseil en Italie, est de notoriété publique. D’après El País, elle serait venue à contrecœur au sommet de Paris et n’aurait pas apprécié la prééminence d’Emmanuel Macron.
Contrairement à la France et à plusieurs pays d’Europe de l’Est, l’Italie, dont le budget militaire est très limité, se montre réticente à l’envoi de troupes en Ukraine.
Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, s’est, lui aussi, montré peu enthousiaste à l’idée d’expédier des forces armées pour sécuriser l’Ukraine.
Méfiante de longue date vis-à-vis de Moscou, la Pologne de Donald Tusk se voit confirmée par l’actualité récente dans sa politique de fermeté à l’égard de la Russie.
Varsovie a porté à 4,7 % du PIB le budget de ses armées pour cette année, soit un niveau plus élevé que chez tous les autres pays membres de l'OTAN, États-Unis compris.
Cité par Libération, Donald Tusk a appelé l’Europe à établir « de toute urgence son propre plan d’action concernant l’Ukraine et notre sécurité, faute de quoi d’autres acteurs mondiaux décideront de notre avenir. »
Également situé sur la mer Baltique, le Danemark compte aussi se réarmer. Les relations entre Copenhague et Washington se sont nettement dégradées depuis que Donald Trump lorgne ouvertement sur le Groenland.
« Nous devons nous renforcer massivement pour protéger le Danemark. Et nous devons nous réarmer massivement pour éviter la guerre », a déclaré Mette Frederiksen, la Première ministre du pays, devant le Parlement, indique Le Figaro.
Quant aux pays baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie), ils se préparent déjà à une invasion russe en cas de désengagement des États-Unis. Leur petite taille et leur proximité avec la Russie en font la probable cible suivante de Moscou après l’Ukraine.
« Si le pont transatlantique ne s'est pas encore écroulé, nous avons le sentiment qu'il est sérieusement endommagé », s’inquiète Māris Andžāns, directeur du Centre d'études géopolitiques de Riga, en Lettonie, cité par France 24.
À l’inverse, la Hongrie de Viktor Orban et la Slovaquie de Robert Fico maintiennent leur position favorable au Kremlin tout en essayant de s’attirer les bonnes grâces de Donald Trump. Une épine dans le pied de leurs partenaires européens !
Au niveau de l’UE, la cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a déclaré que « si un accord est conclu dans notre dos, il ne fonctionnera tout simplement pas », indique Euronews.
Les États européens parviendront-ils à surmonter leurs divisions pour constituer une force autonome entre Washington et Moscou ? Face à la menace existentielle sur leur sécurité, il est plus urgent que jamais de passer des paroles aux actes !
Et aussi
À ne pas manquer